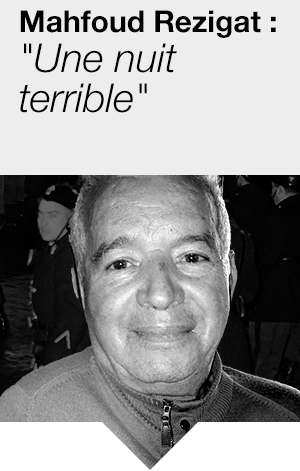“Ils hurlaient, ils gémissaient”
Serge Rameau est né en décembre 1946, à Bucarest, en Roumanie. Avant la fermeture du rideau de fer, et alors qu’il n’a que 9 mois, il est exfiltré par une hôtesse de l’air. Ses parents, eux, mettront trois ans pour rejoindre Paris à pied. Accueilli et élevé en France, il a eu le statut de réfugié politique jusqu’à ses 20 ans avant d’obtenir la nationalité française. Le 17 octobre 1961, l’adolescent s’est retrouvé au milieu de la manifestation alors qu’il sortait du métro place de l’Étoile. Il a alors vu les policiers malmener les FMA. Traumatisé par la violence et les cris, il souhaite témoigner de ce qu’il a vu pour qu’un travail de mémoire soit fait. Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre du Mérite, le chirurgien-dentiste à la retraite est aujourd’hui délégué général de l’association d’anciens combattants Souvenir français et vit en Roumanie.
“J’avais 14 ans et j’étais scout. J’habitais chez ma grand-mère, au 11 boulevard Pereire, dans le 17e arrondissement de Paris. Quand je rentrais des scouts, je descendais à la station de métro Étoile, puis je prenais l’autobus. Je crois que c’était le 52, il m’emmenait jusqu’au pont Cardinet. En sortant du métro, je me suis retrouvé dans une tourmente dramatique. Je n’étais pas au courant qu’il y avait une manifestation. J’étais jeune, je ne m’intéressais pas vraiment à l’actualité. Je ne savais pas que des Algériens avaient appelé à manifester sinon je ne serais pas descendu à la station Étoile.
Il était 5 h du soir, mais en octobre, il fait déjà nuit, pas complètement, mais c’est la pénombre. Il n’y avait que des hommes. Les policiers les attrapaient à la sortie de la bouche de métro et les tapaient. Ils les faisaient monter dans les cars de police en les piquant avec des aiguilles. Ça m’a traumatisé. Ils hurlaient, ils gémissaient. Je me souviens des cris de douleur, de la violence.
Je suis parti le plus vite possible, sans courir car je ne voulais pas attirer l’attention. Je savais très bien que quelqu’un qui court devant la police, ça n’est pas bien vu. J'ai marché vite, je me suis dépêché d’aller vers la station d’autobus mais pas la première. Je suis allé plus loin.
J’étais complètement traumatisé. À cette époque, on était habitué à une certaine violence urbaine. Des sacs de sable protégeaient les commissariats. J’étais au lycée Janson de Sailly (dans le 16e), on nous fouillait les cartables. Un jour, j’étais allé chez le dentiste avec ma grand-mère, boulevard Bonne-Nouvelle, et à deux mètres de moi, un type a sorti un revolver et a tiré une balle dans la tête d’un Algérien.
On était dans cette atmosphère, mais je ne pouvais pas imaginer ça de la part de policiers. À l'époque, on avait un grand respect pour la police, l’autorité, l’uniforme. C’était quelque chose d’incompréhensible pour moi.
Mon oncle était importateur de tapis. Sa société, Les deux pélicans, rue des Gravilliers, dans le 3e, employait des Marocains. Ils mettaient les tapis sur l’épaule pour les vendre et faisaient du porte-à-porte un peu partout. Pendant ces jours dramatiques que Paris a connus, il y a eu des ratonnades. Ses employés n’étaient pas Algériens, mais les policiers ne faisaient pas la différence. C'était vraiment un délit de faciès. Quatre ou cinq employés, sur les dix, ont été pris et jetés dans la Seine. Heureusement qu’on ne leur avait pas lié les mains ! Ils ont réussi plus ou moins à nager et il n’y a eu qu’un mort. J’ai su après qu’il y avait des Maghrébins à qui on avait noué les mains dans le dos et qui s’étaient noyés. Mais je peux témoigner de la violence terrible qu’ils ont subie, surtout de la part de l’État français.
J’ai écouté les informations. J’ai compris qu’il y avait eu une manifestation interdite et que le préfet de police, pour éviter de la disperser, avait ordonné des arrestations en amont. On ne donnait pas de détails. On ne parlait pas de violences impardonnables. On disait seulement que les gens avaient été arrêtés.
Ils n’étaient pas armés. S’ils l’avaient été, ils se seraient battus. Tous les hommes que j’ai vus étaient piqués avec des épingles pour qu’ils montent dans les cars. S'ils avaient eu des bâtons, ils se seraient révoltés. Ces hommes étaient courageux, ils savaient que c’était interdit. Il y a eu plus de morts officieux qu’officiels, des noyés surtout. Ils ont été emportés par le courant, pas comptabilisés.
À l’époque, il y avait une sorte d’apartheid. Les Maghrébins ne vivaient pas du tout dans les mêmes quartiers. Il n’y avait pratiquement que des hommes, ils venaient pour travailler. Les Algériens et Marocains vivaient dans des foyers, il n’y avait même pas de banlieue ouvrière. Ils étaient en dehors de notre société. C'était deux mondes à part.
Maintenant, je me dis que les Français avaient peut-être peur des attentats, mais ils n’étaient même pas dirigés contre eux. Les attentats, c’était le MNA [Mouvement national algérien, NDLR] contre le FLN et inversement, et contre les commissariats de police.
J’ai réalisé la portée de tout cela à 17 ans. J’ai commencé à lire Le Monde quotidiennement, on parlait de Maurice Papon qui avait déporté les juifs de Bordeaux. J’ai su alors que la police agissait sous les ordres du préfet.
Pour moi, l’Homme est foncièrement sauvage. La seule chose qui le retient c’est la loi, la civilisation. Si ceux chargés de l’appliquer disent que l’on a quartier libre, alors on tombe dans la sauvagerie. On a vu ça avec tous les génocides, la barbarie nazie. La responsabilité n’incombe pas tellement au flic qui cognait sur les Maghrébins ce jour-là, mais à la hiérarchie.
On a enlevé la Légion d’honneur de Papon pour la déportation des enfants juifs à Bordeaux, mais pas pour octobre 1961. Sa défense, c’était de dire qu’il était haut fonctionnaire et qu’il obéissait aux ordres. C’est étonnant que [le général] de Gaulle, qui était tout sauf raciste, l’ait nommé préfet de police. C'est un poste-clef, l’État dans l’État. Et il savait très bien qu’il était loin d’être un résistant, mais plutôt un infame collabo.
Je pense que les violences policières sont rarement admises, quel que soit le pays où elles ont lieu. Admettre que le bras armé de la République ait pu commettre des fautes serait perçu comme un aveu de faiblesse. La hiérarchie policière aurait dû dénoncer. C’est ce qui s'est passé avec la rafle du Vél d’Hiv, toute proportion gardée. Le 17 octobre, il n’y a pas eu des milliers de victimes, mais c’est tout de même insupportable. L’idée, c’était de terroriser cette population maghrébine pour qu'elle reste tranquille, certainement pour que l’Algérie reste française.
C'est une page méconnue. J’en parle parce que je l’ai vécue, je l’ai vue de mes propres yeux. J’en parle à des personnes de mon âge ou des plus jeunes, personne n’est au courant. Il y a un travail de mémoire à faire, la justice de la mémoire à réaliser.
Il y a eu huit morts à Charonne le 8 février 1962. Une semaine après, une manifestation de protestation a réuni peut-être un million de personnes dans la rue. Là, pour les victimes algériennes, des personnes qui ont été assassinées, il n’y a pas eu de protestation. Rien.
Que la France, puissance colonisatrice, se soit mal comportée dans les colonies, comme les autres pays européens, c’est une chose. Mais qu’elle se comporte mal sur son propre sol, c’est ça qui interpelle, qui choque. Je n’étais qu’un scout qui rentrait d’une sortie, un scout avec ses principes de solidarité. Je suis tombé sur un massacre en plein Paris, place de l’Étoile. Des scènes de guerre.
Reconnaître qu’il y a soixante ans, il y a eu des fautes inadmissibles commises, serait à l’honneur de l’administration française.”
“J’avais un bébé dans les bras, j’avais peur qu’on le tue”
Djamila Amrane a 87 ans. Son père est arrivé en France en 1914 après avoir été réquisitionné pour travailler dans une usine. Née rue Danielle-Casanova, à Saint-Denis, en banlieue parisienne, c’est après un voyage en Algérie que naît son militantisme pour l’indépendance. Le 17 octobre, son dernier-né dans les bras, elle se rend à la manifestation. Elle doit probablement sa vie à une inconnue. Djamila Amrane gardera le silence sur la tragédie jusqu’en 1987, date de la création de l’association antiraciste et féministe Africa, à La Courneuve. Depuis, elle se bat pour que cette nuit ne tombe pas dans l’oubli.
“Après 18 h, on n’avait plus le droit d’être dehors. Ça me paraissait invraisemblable parce que tous les Algériens travaillaient dans des usines comme Renaud, Citroën, et faisaient les trois-huit, comme on disait à l’époque. Les enfants allaient au sport le soir, les parents faisaient leurs courses le soir. C’était une grande injustice venant de Papon.
La Fédération de France du FLN avait donc demandé à ce qu’on fasse une manifestation pacifique, une sorte de marche blanche. J’insiste parce qu’il nous était interdit de prendre ne serait-ce qu’une épingle à nourrice.
Nous avions formé un petit groupe de femmes pour aller à Paris. Nous sommes toutes parties avec les enfants. Moi, avec mon dernier fils, né en juillet. Nous avons atterri à Bonne-Nouvelle. Malheureusement, dès que nous sommes arrivées, nous avons trouvé la police.
Ce qui m’a marquée, c’est la façon dont les policiers nous tapaient dessus. Peu importe si on était une femme, si on avait un bébé ou si on était un homme. Tout le monde était pris à part. Les coups venaient de partout. On entendait tout, sans savoir qui allait tomber par terre. La seule question qu’ils posaient, c’était “Est-ce que tu sais nager ?”. Si vous aviez le malheur de répondre non, ils vous emmenaient pour vous jeter à la Seine.
J’avais un bébé dans les bras, j’avais peur qu’on le tue, qu’il prenne un mauvais coup. Il n’avait que quelques mois. Je crois que je devais être inconsciente, la folie de la jeunesse, je ne voyais pas le danger. J’avais cette rage en moi.
Ce qui m’a sauvée, c’est cette femme. Elle a ouvert une porte cochère en bois, m’a attrapée par le bras et m’a fait entrer dans le hall de chez elle. Elle m’a dit “Mais qu’est-ce que tu fais dans la rue à cette heure ma petite fille, avec ton petit frère dans les bras ? Ta maman n’est pas consciente !” Je lui ai dit “Non, c’est mon fils.”
Je revois cette femme avec des cheveux blonds, c’est fou comme j’ai l’impression qu’elle est là, devant moi. Elle m’a gardée une bonne heure. Sans cela, peut-être qu’aujourd’hui je ne serais pas là pour vous dire tout cela. J’ai presque un seul reproche à me faire... Nous étions tellement pris dans cette guerre que je ne lui ai même pas demandé son nom.
L'envie d’indépendance de l’Algérie m’est venue quand je suis allée là-bas, en 1954-1955. J’avais fait des études, j’étais déjà bien plus libre que ces femmes. J’ai été choquée de ne voir que des femmes ignorantes, des femmes de ménage, elles étaient en bas de l’échelle. Elles étaient plus jeunes que moi. Pourquoi n’avaient-elles pas le droit d’aller à l’école ? Je ne comprenais pas. Algérie française ? Je n’arrivais pas à concevoir la différence entre les petits Français et les ‘bougnoules’ comme ils nous appelaient. C'était un électrochoc. Ça m’a traumatisée. Je me suis dit, si un jour il y a quelque chose, j’y participe. Dès que je suis rentrée en France, je me suis engagée.
De nombreux participants à cette marche ont été tués. Ils n’ont jamais voulu donner le nombre, mais on sait qu’il y en a eu beaucoup. J’ai un cousin, c’était presque un frère pour moi car ma mère l’avait élevé, on ne l’a jamais retrouvé. Deux ou trois jours après, on a appris qu’il y avait de nombreux disparus, lors d’une réunion du FLN.
J'étais la première à ne pas parler du 17 octobre. Personne ne savait. Même mes enfants ne l’ont su qu’après. Intérieurement, je crois que je n’avais plus envie de revivre cette scène. C’est comme quand on a vu un mauvais film, on n’a plus envie de le revoir. J'avais dû l’enfouir quelque part. C’est grâce à Mimouna Hadjam, présidente de l’association Africa, que c’est ressorti. Elle en parlait, je lui ai dit que j’étais là. Je n’aurais jamais pensé qu’un jour je reparlerais de tout ça... Ce n’est pas un bon souvenir. J’aurais pu non seulement mourir mais aussi perdre la vie de mon fils. Ça m’a fait un bien fou par la suite.
Quand j’ai commencé à travailler avec Africa, on me demandait souvent “C’est quoi le 17 octobre ? C’est une date ? C’est une fête ?”. Non, des gens sont morts le 17 octobre. D’autres ont été battus, pris comme du bétail pour les emmener dans un parc, je crois que c’était le parc de Vincennes.
Il ne faut pas que les gens oublient ce que les Allemands ont fait aux juifs. Ils les ont exterminés. Nous, c’est pareil avec le 17 octobre 1961. J’aimerais avant tout qu’on n’oublie pas. C'est important. Il faut reconnaître que c’est une date dans l’Histoire.
C'est le 60e ‘anniversaire’, si on peut appeler ça comme ça. J'attends de l’État français qu’il reconnaisse que le 17 octobre on a tué des Algériens, des Algériennes. Qu’en France, et ailleurs dans le monde, on en parle dans les lycées, les collèges, les écoles parce que, malheureusement, c’est méconnu.
On se rassemble chaque année avec des personnes présentes ce jour-là. Je ne le fais pas pour être honorée. Aujourd'hui, je suis là. Mais je ne suis pas éternelle. Bientôt, il n’y aura plus personne pour dire le 17 octobre.
Si je parle, ce n'est pas pour avoir des honneurs. Les honneurs, je les ai par mes enfants et mes petits-enfants qui m’appellent ‘mamie courage’. Ils sont très fiers de moi. Mais je voudrais qu’il y ait une relève, que ça se perpétue pour que tous ces gens ne soient pas partis pour rien. C'est un jour triste pour nous, il ne faut pas l’oublier.”
“J’ai passé la nuit dans le parc de Vanves”
Mahfoud dit “Rahim” Rezigat est né en 1940 dans le douar Maâdid, dans la région de Sétif, en Algérie. En 1948, accompagné de trois frères plus âgés, il s'installe à Saint-Étienne où leur demi-frère aîné tient un hôtel meublé. Membre du FLN, il est arrêté en 1958, torturé puis envoyé dans les camps d’internement du Larzac et de Thol. Libéré en 1961, interdit de séjour dans la Loire et le Rhône, il s’installe à Vanves, en banlieue parisienne. Le 17 octobre, c’est parce qu’il a croisé, dans le métro, des Algériens qui revenaient de la manifestation, qu’il a fait demi-tour. Interpellé à son hôtel quelques jours plus tard, il a subi sévices et humiliations au centre de tri de Vincennes. Aujourd'hui, président de l’Association pour la promotion des cultures et du voyages (APCV) basée à Saint-Denis, il œuvre pour la mémoire du 17 octobre, notamment en intervenant dans les lycées.
“Le 17 octobre, je revenais du travail, à Issy-les-Moulineaux, avec mon ami Saâd et un groupe d’Algériens de l’hôtel où nous vivions. Il était 17 h. Le responsable de la cellule du FLN nous a demandé de nous diriger vers Charles-de-Gaulle-Étoile pour manifester contre le couvre-feu. Il a été instauré le 5 octobre, donc tous les regroupements d’Algériens, ou plutôt de basanés, étaient interdits. J’étais souvent contrôlé.
Les consignes du FLN était claires : on ne devait pas prendre d’arme avec nous ; on devait être bien habillés pour montrer qu’on était fiers d’être Algériens. C’est avec cet état d’esprit que nous sommes partis.
Nous avons pris le métro à Corentin-Celton. Arrivés Porte de Versailles, d’autres Algériens, qui revenaient de Paris, nous ont crié : “N’y allez pas !”. Ils avaient commencé à arrêter les gens.
Nous sommes retournés à notre hôtel. Il était en face du commissariat de Vanves. La rue Pierre-Semard était en descente, on voyait de loin que l’hôtel était déjà encerclé par les CRS et la police.
Avec mon ami Saâd, on s’est demandé quoi faire. Nous sommes donc allés dans une brasserie, boire un pot. À 20 h 30, nous sommes retournés à l’hôtel mais la police était toujours là. Nous avons dû passer la nuit dans le parc de Vanves, qui était juste à côté. À 6 h, nous avons rejoint notre lieu de travail, à Issy-les-Moulineaux.
Le vendredi, il y a eu une descente de police terrible dans cet hôtel. J’étais à la fenêtre. On a tiré sur quelqu’un qui faisait ses ablutions avant la prière. Il a été abattu. On a passé une nuit terrible.
Les harkis – et je n’ai aucune haine envers eux –, les supplétifs, étaient autorisés à être bien plus virulents. On entendait : “Vous voulez l’indépendance, vous allez voir sales fellagas, ratons, pouilleux !”. Insultes, crachats... Ils avaient aménagé une pièce au fond de l’hôtel et tous les gens qu’ils soupçonnaient y étaient emmenés pour être torturés.
Tous les résidents ont été embarqués, y compris moi, au centre de tri de Vincennes. Il était connu pour ses détentions provisoires très difficiles avec transfèrement ou expulsion des détenus. Il y avait deux files de policiers ou de CRS, et comme on passait au milieu, on recevait des coups de bâton, des coups de pied, des crachats. Comme j’étais petit, je m’en suis pas mal sorti. On ne nous laissait pas dormir. On nous jetait de l’eau pour nous réveiller.
Le lendemain, on m’appelle pour me dire ‘Vous êtes libre’. J'étais étonné, mais je suis parti. En fait, ils ne savaient pas que j’avais fait trois ans dans les camps, sinon ils ne m’auraient pas libéré.
Il y a eu des attentats contre les policiers au mois d’août. D’après le FLN, étaient visés ceux qui pratiquaient la torture sur les Algériens arrêtés. Par la suite, Papon a dit : “Pour un policier tué, dix Algériens” ("Pour un coup reçu, nous en rendrons dix"). Il est aussi possible que cette répression ait eu pour but de torpiller les négociations entre le gouvernement français et le FLN puisqu'on commençait les accords d’Évian.
Aujourd’hui, j’attends du président Macron qu’il qualifie le 17 octobre de crime d’État et qu’il donne l’accès aux archives. J’espère, surtout, qu’à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, l’an prochain, il reconnaîtra la colonisation comme un crime contre l’humanité. Il l’avait affirmé quand il était encore candidat à la présidentielle.”
“Ça tirait de tous les côtés, les femmes et les enfants autour de moi avaient très peur”
Monique Hervo a 92 ans. Née dans un milieu modeste, d’un père breton “bretonnant” (sic), d’une mère savoyarde, elle fait l’école des arts décoratifs à Grenoble puis les Beaux-Arts à Paris. Elle a connu l’exode, les bombes, le mitraillage sous l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, à la libération, son engagement scout lui fait escorter des déportés à leur retour du camp de Buchenwald. Elle est “marquée à vie”. Elle décide alors de s’engager au sein du Service civil international. En 1959, elle s’installe dans le bidonville de Nanterre, où vivent 10 000 Algériens. Le 17 octobre, elle était dans le cortège quand les CRS ont tiré sur les manifestants qui arrivaient au pont de Neuilly. Elle les a ensuite secourus, soignés. Devenue Algérienne en 2018, elle veut laisser une trace de cette histoire vécue.
“Avant le 17 octobre, le FLN me demandait chaque soir de dormir chez les femmes qui étaient seules dans le bidonville. Leurs frères, les pères avaient été embarqués ou avaient pris des dispositions pour coucher sur le lieu de travail. Il n’y avait pas d’hommes, à part quelques responsables du FLN. Depuis le mois de janvier, il y avait des arrestations, des tabassages.
Le 17 au soir, je rentrais avec une petite équipe qui s’était engagée pour l’indépendance de l’Algérie. Je suis arrivée vers 6 h du soir pour passer la nuit comme d’habitude. Et là, et je vois une masse d’Algériens et d’Algériennes, d’enfants qui sortent du bidonville. Je me dis alors qu’il se passe quelque chose. À ce moment-là, un homme que je connaissais me dit ‘tu viens avec nous’. Tout le monde est sorti, sauf les femmes qui allaient accoucher. Elles ont gardé les bébés des autres.
Il y avait une dizaine de femmes. Ils ne voulaient pas de militants extérieurs ou de Français. Parce que je vivais au bidonville depuis 1959, j’en faisais partie. J'avais pris position pour l’indépendance de l’Algérie. Je suis une des seules Françaises qui ont pu tout voir.
Des personnes arrêtaient tous les hommes à la sortie du bidonville pour vérifier qu’ils n’aient pas même un canif sur eux. On est partis et, au rond-point des Bergères (à Puteaux, NDLR), on a vu arriver tous ceux qui venaient des banlieues d’à côté : Colombes, Gennevilliers... une masse considérable. J’ai toujours dit il y avait eu au moins 40 000 manifestants.
On a descendu l’avenue qui allait au pont de Neuilly dans un silence impressionnant. La seule chose que j’ai entendue, c’est ‘Algérie à nous’. C’était le slogan, il n’y en avait pas d’autre. Les femmes et les enfants étaient mélangés aux hommes. Tous les trottoirs étaient envahis par des Algériens et des Algériennes.
À 200 mètres, mais c’est difficile à situer parce que c’était en pente à l’époque, on a vu les CRS sur le pont de Neuilly. Et d’un seul coup, les CRS ont tiré. À balles réelles ! Je vois encore les hommes du premier rang tomber. Ce n'était pas la première fois que ça se produisait. Il y a eu énormément d’Algériens qui se sont fait tirer dessus avant d’être jetés dans la Seine. J’en ai vus. J’en ai vus qui étaient blessés et qui essayaient de s’accrocher au bord de la Seine pour se sauver. Ce n’est pas quelque chose qu’on imagine.
Ça tirait de tous les côtés, les femmes et les enfants autour de moi avaient très peur. Je ne sais pas comment ça a pu se produire, mais les hommes les ont extraits du cortège. Ils disaient que c’était trop grave, qu’ils pensaient qu’on allait à une marche pacifique. Les femmes et les enfants sont partis sur le côté, vers Puteaux, et ont rasé les murs pour retourner au bidonville de Nanterre. On ne faisait surtout pas de bruit de peur qu’on nous tire dessus, parce qu’il y avait des gens aux fenêtres.
Au bidonville, on ne savait pas ce qu’il se passait sur Paris. Au petit matin, vers 5 ou 6 h, on a vu des hommes arriver complètement esquintés. Certains en portaient d’autres qui ne pouvaient même plus marcher. C'est là qu’on a compris.
Le bidonville est devenu un hôpital de campagne. Brigitte, une assistante sociale française, et une amie sont venues soigner les blessés. On a fait comme on pouvait. On bandait les membres cassés. On l’a fait pendant des jours. L’hôpital, c’était la maison départementale de Nanterre. Raymond Montaner avait créé les FPA, dont les membres habitaient une annexe de l’hôpital. Si les Algériens allaient là-bas, ils étaient enfermés, matraqués ou envoyés dans les camps de Rivesaltes.
Il y a des hommes qui ne se sont jamais remis du 17 octobre, à la fois physiquement et moralement. Ça a été quelque chose de très puissant pour les Algériens et Algériennes qui étaient mobilisés pour la reconquête de leur pays. Ça a été un accélérateur.
Les médias en ont un peu parlé et le bilan ne correspondait pas à la réalité. C’est quelque chose dont il ne fallait pas parler. Ce n'était pas une guerre, il faut se le rappeler. C’était les ‘événements d’Algérie’. On était en porte-à-faux.
En 1999, Maurice Papon a intenté un procès à Jean-Luc Einaudi pour son livre sur les événements et l’emploi du mot ‘massacre’. J’ai témoigné. À la fin, le président a déclaré qu’il y avait bien eu un massacre. Ce mot est important. Souvent on dit il y a eu répression. Non ! Il y a un monde entre répression et massacre.
Ça n’a pas eu énormément d’écho dans la presse. Ça arrivait après le procès de Maurice Papon à Bordeaux, où il avait été condamné. Ça a été passé un peu sous silence.
Je reçois beaucoup de jeunes. Ils connaissent la situation d’aujourd’hui, mais ne savent rien de leur pays d’hier. C’est inquiétant. Après la guerre, les parents ont dit ‘vous allez faire les études que nous n’avons pas eues’, nous restons pour vous, pour l’école. Ils n’ont pas raconté à leurs enfants ce qu’ils avaient vécu pour qu’ils s’intègrent à l’école. Ils sont devenus des petits Français. Les parents n’ont pas imaginé qu’en ne racontant pas toutes les difficultés, les enfants seraient un peu perdus. Aujourd’hui, les jeunes gens de l’immigration ne se rendent pas compte de ce que ça pouvait être parce qu’ils ne l’ont pas vécu.
J’ai été naturalisée en 2018. On m’avait proposé une carte d’identité algérienne à l’indépendance, mais on était tellement pris avec ceux qui repartaient, ceux qui voulaient rester que je n’ai pas eu le temps de m’en occuper. Je me sens proche des Algériens parce que j’ai connu les grands-parents et les parents. Pour moi, c’est l’humain qui compte.”