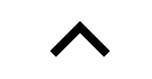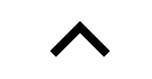Cliquez pour naviguer

Migrants sur le port du Pirée. © Sarah Leduc / France 24
D
ans la mythologie grecque, le "Chaos" est une crevasse ténébreuse. En Grèce des milliers de migrants semblent s’y être précipités. C’est à Athènes que nous poursuivons ce reportage pour comprendre les implications de l’accord européen. La capitale grecque s'est transformée en un vaste camp de migrants depuis que les îles ont été vidées. Sur les 51 000 personnes toujours coincées dans le pays, plus de 12 100 se trouvaient à Athènes début avril, dont 5 500 sur le port du Pirée et 4 360 dans l'ancien aéroport d'Hellenikon.

Carte affichée au port du Pirée pour orienter les migrants vers les différents centres d’accueil d’Athènes. © Benjamin Dodman / France 24
Le port du Pirée,
une "bombe à microbes"

© Sarah Leduc / France 24
Casquettes sur la tête et valises à portée de main, deux touristes croquent dans leur sandwich, attendant, à l'abri du soleil de l'après-midi, le paquebot qui les transportera vers l'une des centaines d'îles aux ruines antiques. Devant eux, une mer azur qui appelle au plongeon. La scène pourrait sembler banale au Pirée, le plus grand port du monde pour le trafic des passagers. En moyenne, 12 millions de voyageurs y transitent chaque année. Mais en ce début de printemps, le couple semble un peu perdu, et à mesure que les minutes passent, leur casse-croûte perd de sa saveur. Nous aussi, d’ailleurs, nous sommes désemparés face à cette scène : partout, autour de nous, des milliers de migrants, qui attendent, non pas un bateau, mais un destin.
Dès que les frontières rouvrent, je pars d'ici
Muswhtaq Amiri, migrant afghan

À 24 ans, Muswhtaq Amiri a fui l’Afghanistan début mars. Il est arrivé le 20 au port du Pirée. © Sarah Leduc / France 24
"Dès que les frontières rouvrent, je pars d'ici. Les conditions sont trop mauvaises : on dort par terre, c'est bourré de monde, en plus il n'y pas de travail. Je veux aller en Belgique, s'il le faut, je marcherai jusqu'à Bruxelles. Marcher, ça me fait pas peur", explique dans un sourire doux Muswhtaq Amiri. À 24 ans, il en a vu d'autres. Muswhtaq a fui l'Afghanistan début mars. Puis, il a embarqué en Turquie sur un pneumatique lancé sur la mer Égée, ce jour-là déchaînée. "On était beaucoup trop nombreux sur le bateau, on a failli couler. On a dû écoper avec nos chaussures. Vous n'avez pas vu ? On a même été filmé par BBC !" Ces images sont devenues beaucoup trop familières depuis plusieurs mois et ils sont nombreux à partager la même expérience. Sauvé des eaux par un navire de Frontex, l'agence de surveillance des frontières de l'Union européenne (UE), le jeune homme a finalement débarqué à Lesbos, où il a été enregistré avant d'être envoyé, le 20 mars, au port du Pirée.
Les tentes s'étendent à perte de vue, igloos de toiles qui longent des entrepôts abandonnés. Les terminaux et salles d'attente normalement réservés aux passagers des ferries servent désormais de refuges provisoires. Sans douches, sans chauffage. Quelques dizaines de toilettes seulement. "Avec la chaleur qui arrive, ça risque de devenir une bombe à microbes", redoute Anna Sotiropoulou, médecin pour l'ONG Praxis, qui intervient dans le camp. Étalées sur le sol, les couvertures grises distribuées par le HCR servent de tapis où l'on mange, on joue aux cartes, on se coiffe. On y prie aussi.

Attendre le temps qui passe sur le port du Pirée. © Sarah Leduc / France 24
Malheureusement les dieux, même tous ceux du panthéon grec réunis, n'y peuvent pas grand-chose. Le sort de ces milliers de personnes est entre les mains d'agents européens dont la mission consistera à les interroger un à un, pour valider – peut-être – leur demande d'asile et, le cas échéant, les "relocaliser" en Europe, en fonction de quotas préétablis par Bruxelles. Encore faudrait-il que tous les États de l'UE, plus divisée que jamais, jouent le jeu de la "relocalisation". Ce que la Hongrie, la Serbie, la Slovaquie, la Pologne et la Macédoine refusent en bloc, parfois pour des raisons de politique intérieure.
On nous a dit : 'C'est pas vous qui choisissez, c'est un pays qui vous choisit'
Youssef, migrant syrien
"Quand on a demandé l'asile, j'ai mis la France et la Suède comme premiers choix. Mais on nous a dit : 'C'est pas vous qui choisissez, c'est un pays qui vous choisit'", explique Youssef, ingénieur en communication de 35 ans, originaire d'Idleb, en Syrie. Contrairement à Muswhtaq Amiri, Youssef tient désormais à faire les choses dans les règles. Arrivé sur le Pirée le 20 mars avec sa femme et leurs quatre enfants âgés de 7 mois à 10 ans, il ne veut plus faire prendre de risque à sa famille. "Après la traversée en bateau, j'ai décidé de ne plus passer par des routes dangereuses. Je n'irai pas à Idomeni où ils dorment dans la boue, je ne donnerai plus d'argent à des passeurs. Je veux garder le peu qu'il me reste pour recommencer une nouvelle vie, ailleurs, en sécurité, et de préférence pas en Grèce où je ne vais pas trouver un bon travail, dans une grande compagnie." Selon le plan de quota européen, la Grèce devra à terme offrir 20 000 hébergements aux migrants. Mais pour l’instant le pays, qui a frôlé la faillite, n'attire pas les candidats à l’asile.
La vie quotidienne sur le port du Pirée
À l'heure de la rigueur

“La Mort de l’Euro”, par le street artiste, Goin, à Athènes, le 19 juin 2015. © Aris Messinis / AFP
La marée humaine qui a déferlé sur la mer Égée ces derniers mois a frappé un pays où plus de 3 millions d'habitants, sur un pays qui en compte 11, vivent sous le seuil de pauvreté. Peu émus des efforts fournis par la Grèce dans la prise en charge des migrants, les créanciers européens et internationaux ne relâchent pas la pression et jugent la réduction des dépenses encore insuffisantes. Ils étaient de retour avant Pâques : Bruxelles et le FMI exigent de nouvelles coupes dans les retraites qui, déjà rabotées à plus de dix reprises ces cinq dernières années, plafonnent à 384 euros par mois.
Le peuple grec a l'habitude de combler les déficiences de l'État. Les citoyens n'attendent pas beaucoup de lui, donc ils se débrouillent
Georges Prévélakis, politologue
Pourtant élu en janvier 2015 sur un programme anti-austérité, Alexis Tsipras a perdu, l'été dernier, sa bataille face aux créanciers, se discréditant au passage auprès d'une partie son peuple qui en a conclu qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Après six ans de crise et d'austérité, les Grecs ont développé de solides réflexes de solidarité, palliant l’insuffisance des structures officielles. "Le peuple grec a l'habitude de combler les déficiences de l'État. Les citoyens n'attendent pas beaucoup de lui, donc ils se débrouillent", nous expliquait Georges Prévélakis, professeur en géopolitique à Paris-1-Sorbonne, que nous sollicitions avant de partir pour ce reportage pour "défricher le terrain".

Sans-abri installés à quelques centaines de mètres des migrants, sur le port du Pirée. © Sarah Leduc / France 24
Les ONG et réseaux de solidarité se sont multipliés dans la capitale pendant la crise, comme Emphasis, lancée en 2013. Initialement prévue pour les Grecs en situation précaire, elle a naturellement élargi son champ d’action aux migrants. Nous accompagnons ses volontaires, lors d'une maraude nocturne au port du Pirée, où migrants et SDF sont établis à quelques centaines de mètres de distance, sans jamais se côtoyer, comme si la misère des uns étaient insupportables aux autres. "L'État a délégué aux individus et aux ONG la prise en charge des personnes en grande précarité. Il fait la même chose avec les migrants", assure Zoanna Tsoukala, chef des équipes de terrain. D'après ses chiffres, Athènes comptait 27 000 sans-abri début 2016, et elle s'attend à voir ce nombre augmenter d'ici à l'été. "Les gens n'arrivent plus à rembourser leur prêt et ils sont de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir payer leur loyer", affirme-t-elle. Éparpillés par petits groupes, des hommes et des femmes se protègent des nuits encore fraîches du mois d'avril, sous plusieurs couches de couvertures.
Que fait l’État pour nous ? Rien. L’État n’aime que les Syriens
Ianis, 52 ans, SDF
Ianis, 52 ans, à la rue par intermittence depuis 2010, reçoit le thé chaud et sucré avec un sourire en coin. Il a d'abord perdu son emploi d'agent de sécurité, puis son toit. Depuis, il n'arrive plus à se sortir de la spirale de la précarité. "L'État nous a laissés tomber. J'ai essayé de retrouver du travail, mais personne ne m'a aidé. La situation ne fait qu'empirer et l'arrivée des migrants n'arrange rien", râle-t-il. "Depuis deux mois, tout le monde aide ceux qui arrivent des bateaux, mais pas nous. À eux, on leur donne à manger, des tentes. Il y a dix jours, j'ai demandé une couverture au Pirée et ils ont refusé en disant que c'était pour les réfugiés ! Que fait l'État pour nous ? Rien. L’État n'aime que les Syriens. Il faut en finir avec les migrants !", s'insurge-t-il. "Kaput les migrants !", surenchérit un homme près de lui, en envoyant valser son thé.
À l’aéroport d’Hellenikon, la fin du voyage

Longtemps absent de la gestion de la crise migratoire, l'État grec a fini par prendre en charge une partie de l'accueil. Il a ouvert en décembre 2015 un ensemble de trois camps dans le nord d'Athènes, hébergeant plus de 4 350 personnes sur l'ancien complexe aéroportuaire d'Hellenikon, qui comprend un aéroport et deux stades construits en 2004, pour les Jeux olympiques.
Nous tentons notre chance, afin de découvrir ces infrastructures officielles. Il est plus facile de s’introduire dans l’ancien aéroport que dans les stades, bien gardés par la police. Nous nous faufilons à l’insu des humanitaires qui distribuent les coupons des rations alimentaires matinales. Force est de constater que mis à part le toit qui protège des intempéries, les conditions d'accueil sont à peine meilleures qu'au Pirée, camp improvisé entièrement délégué aux ONG.
Du linge pend aux rampes d'escalier. Des centaines de tentes s'enchevêtrent sur un lino noirci. Quatre douches pour les hommes, pas plus pour les femmes. Des toilettes qui se comptent sur les doigts d'une main. Odeur de sueur et de sommeil. Toux qui racle les gorges. Dans une première salle, une majorité d'Afghans. Dans la suivante, des Iraniens, des Pakistanais, des Irakiens et parmi ces derniers, sept familles de Yézidis. Vingt-six personnes au total qui se sont naturellement rapprochées, comme pour recréer un semblant de vie de village et de normalité.

Vieille femme hazara originaire de la ville d’Hérat, dans l’ouest de l’Afghanistan, échouée à Hellenikon. © Sarah Leduc / France 24
Ines Haji, liane brune d'une vingtaine d'années, s'active pour préparer le repas de ses quatre enfants âgés de 3 à 11 ans. Son seul fils, "Leo, comme Messi", précise son père, dort encore dans une tente, impeccablement rangée. Victuailles dans un coin, lingettes dans un autre, Ines tient son carré de plastique comme elle tenait sa maison, à Bashiqa, près de Mossoul, en Irak. Il en va de sa dignité. "On n'est pas des animaux", souffle son mari, Hassan. Cet infirmier de 36 ans nous invite à prendre place dans son "village". "Vous savez si les frontières sont ouvertes ?", demandent Hassan et son jeune voisin de tente, Malala Alkhany.
On n'est pas des animaux
Hassan Haji, Yézidi de Mossoul
La famille Haji a quitté l'Irak le 27 janvier, imaginant qu'elle atteindrait son but – l'Allemagne – en une semaine. Depuis, ils se sont heurtés à l'hostilité des Peshmerga qui ont refusé de les laisser passer par les monts Sinjar, ont passé un mois en Turquie, ont traversé la mer sur un pneumatique avec 90 personnes pour s'échouer, quatre heures plus tard, sur l'île de Chios. Là, ils ont été enregistrés puis envoyés à Athènes, avec l'autorisation de rester dans le pays pendant six mois. Ils n'en attendaient pas tant : comme des milliers d'autres, ils pensaient que la Grèce ne serait qu'une étape. Mais depuis la fermeture de la "route des Balkans", l'Allemagne semble un peu plus lointaine chaque jour. "On ne peut pas rentrer ! On n'a plus rien : plus de maison, plus de voiture, bientôt plus d'argent. Chez nous, Daech veut nous tuer. Jamais je ne rentrerai chez moi, mais je ne sais plus où aller", soupire Hassan, pris au piège, entre espoirs déçus et rêves brisés.

La famille Haji dans le camp officiel d’Hellenikon, à Athènes. © Sarah Leduc / France 24
Comme si elle avait senti la détresse de son père, sa fille de 3 ans se jette dans ses bras et la vie reprend aussitôt le dessus. Hassan rayonne. Il nous demande de tirer le portrait de sa famille. Inès attire à elle "Leo-comme-Messi" qui nous toise les yeux plein de sommeil. Pause. Sourires. Photo. Hassan prend nos mains dans les siennes. "Merci", sourit-il. "Nous sommes désolés", a-t-on envie de répondre.
Survivre à Hellenikon